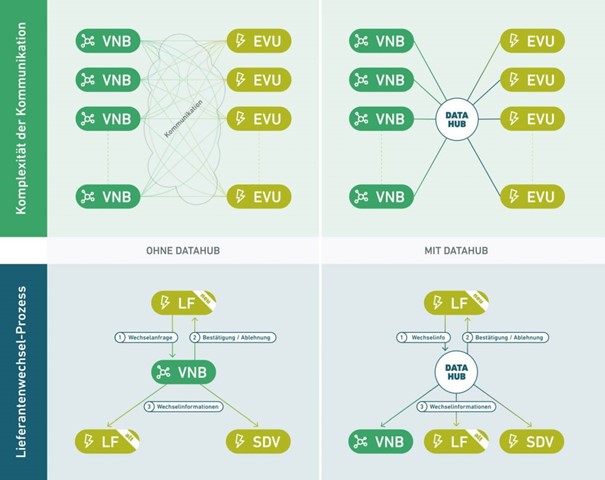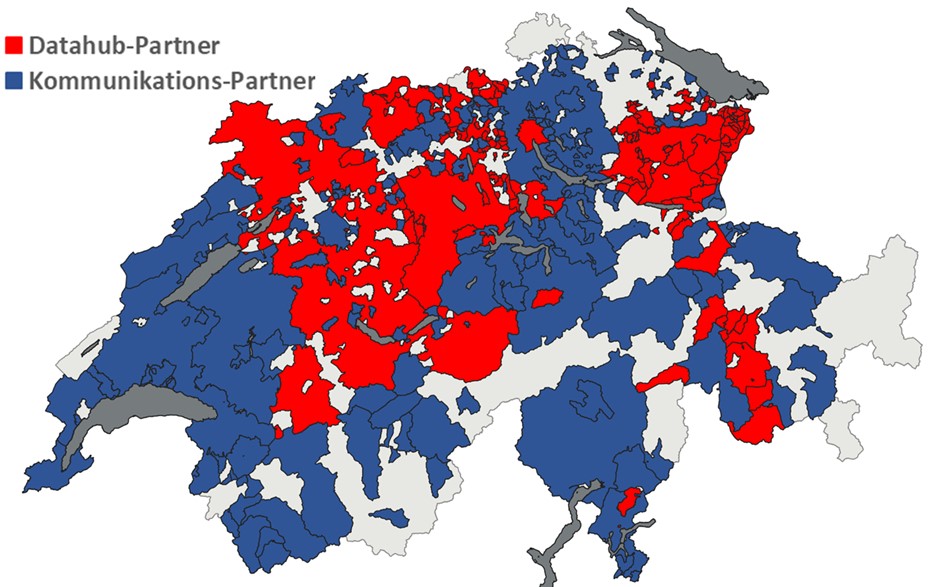Dans le cadre de ses efforts constants en vue d’un approvisionnement énergétique plus durable et plus efficace, la société Kraftwerk Göschenen AG (KWG) s’apprête à franchir une étape importante : l’examen de la faisabilité d’un rehaussement du barrage du lac de Göscheneralp. Ce projet promet non seulement une légère augmentation de la production d’énergie, mais aussi un report important de la production d’énergie vers les mois critiques de l’hiver. Cet article met en lumière les différents aspects de ce projet innovant.
Le 11 janvier 2024, KWG a annoncé qu’elle envisageait un avant-projet ambitieux visant à rehausser le barrage de Göscheneralp de jusqu’à 15 m. Cette mesure fait suite à la nécessité d’optimiser l’approvisionnement énergétique en Suisse, notamment pendant les mois d’hiver. Le rehaussement du barrage n’entraînerait certes qu’une augmentation marginale de la production d’énergie, mais le volume de stockage plus important permettrait un report précieux de la production vers l’hiver, ce qui contribuerait à réduire ce que l’on appelle le déficit hivernal.
Un aspect important du projet, mené par CKW et soutenu par Axpo, les CFF et des prestataires de services externes, est l’évaluation complète de la faisabilité technique, écologique, juridique, politique et économique. La variante de 15 m est au centre de l’attention, même si, selon Thomas Reithofer, président du conseil d’administration de KWG, elle reste un défi économique. Les chances de succès dépendent de différents facteurs, et notamment des contributions à l’investissement, des conventions sur la valeur résiduelle et des adaptations des contributions des centrales en aval.
L’avant-projet met également en lumière les conséquences écologiques et les mesures de remplacement. Il examine les éventuels problèmes de sédimentation dus au refoulement dans les conduites d’amenée d’eau ainsi que la sécurité structurelle et de fonctionnement tout au long du parcours des eaux motrices. En outre, une étude de diverses variantes sera réalisée pour les adaptations nécessaires de la chambre d’équilibre.
Outre le renforcement de la production d’énergie, le projet apporte également une contribution importante à la sécurité d’approvisionnement nationale. Le rehaussement du barrage fait partie de la déclaration finale de la table ronde consacrée à l’énergie hydraulique, signée par des acteurs importants du secteur de l’énergie hydraulique et des associations environnementales. Le rehaussement du barrage permettrait à KWG d’accroître l’efficacité de sa production d’énergie en stockant davantage d’eau pour l’hiver et en déplaçant ainsi la production d’énergie de l’été vers l’hiver.
Le rehaussement du barrage de 15 m augmenterait la capacité de stockage du lac de Göscheneralp de 28%, ce qui est considérable, et permettrait un transfert hivernal d’environ 60 GWh dans l’ensemble de la « Reusskaskade » (une suite de centrales hydroélectriques composée des trois centrales de Göschenen AG, Wassen et Amsteg). Une étape décisive pour combler le déficit hivernal dû à la disparition des centrales nucléaires et pour éviter de futures pénuries.
Thomas Reithofer souligne l’importance de l’avant-projet : il doit créer une base solide pour pouvoir décider du rehaussement du barrage en toute connaissance de cause. Les travaux de construction pourraient démarrer au plus tôt en 2026, et devraient durer de quatre à cinq ans, selon les prévisions de KWG. Le projet ne représente donc pas seulement un jalon de la politique énergétique, mais aussi une étape décisive vers un avenir énergétique sûr et durable pour la Suisse.
Pour plus d’informations :
https://www.ckw.ch/ueber-ckw/medienstelle/medienmitteilungen/2024/die-kraftwerk-goeschenen-ag-prueft-in-einem-vorprojekt-die-machbarkeit-der-dammerhoehung